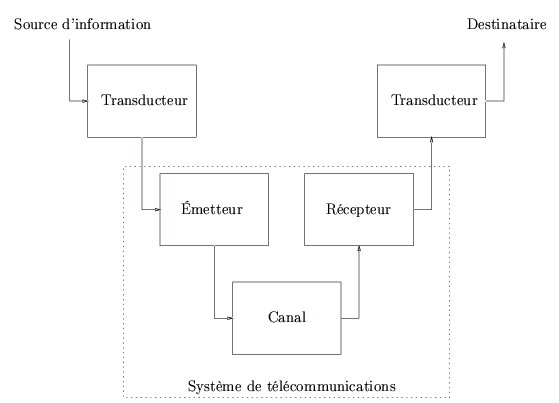
|
L'interactivité ne nécessite nullement l'usage d'un réseau puisqu'une machine dotée de l'interface adéquate suffit. Il en va tout autrement lorsque plusieurs acteurs interviennent, auquel cas l'usage d'un réseau s'impose tout naturellement.
Avec le concours du réseau mondial Internet, les applications multimédia subissent une véritable mutation et, de nos jours, il n'est plus rare d'utiliser une application sans savoir exactement où se trouvent ses composantes. On parle ainsi de Network Computer (NC), c'est-à-dire d'ordinateurs qui vont chercher les applications dans le réseau auquel ils sont connectés.
Pourtant, les problèmes d'une communication sur un réseau sont multiples: il faut garantir que l'information parvienne bien à destination, assurer l'intégrité des données transmises, offrir un niveau de qualité de service, etc. Au vu de cette complexité, les organismes de normalisation ont travaillé à définir une communication sous deux angles: un angle logique et un angle matériel.
La structure conventionnelle d'une chaîne de télécommunications comprend différents éléments repris à la figure 3.1. On part d'un message, d'une information, transmis sous une forme matérielle déterminée. Le système de transmission étant de nature électromagnétique, il convient de convertir le signal physique en un signal électrique par le biais du transducteur d'émission. La chaîne se termine de même par un transducteur de réception, dont le but est de transformer le signal électrique en une grandeur physique adaptée au correspondant destinataire.
Le problème de la transduction est essentiellement un problème de fidélité; ce problème technologique peut être résolu de façon plus ou moins satisfaisante selon le compromis qualité-coût que l'on accepte.
Le signal électromagnétique délivré par le transducteur d'émission doit être adapté au canal de transmission. À cet effet, on lui fait subir certaines transformations auxquelles on peut donner le nom générique de codage. Ces opérations comprennent aussi bien les opérations de filtrage que des mises à niveau électrique ou des convertisseurs d'analogique en numérique. Au terme du codage, que l'on qualifie le plus souvent de codage de source, le signal est injecté à l'entrée d'un système qui effectue le codage de canal ou modulation.
Bien entendu, on opère à l'extrémité réceptrice des opérations de décodage inverses des transformations effectuées à l'extrémité émettrice.
Si la structure de la figure 3.1 correspond assez bien à une chaîne de télécommunications analogiques, de nombreux éléments supplémentaires viennent s'ajouter dans le cas d'une communication numérique. Le schéma de la figure 3.2 en dresse un portrait plus typique. On y voit que la transmission est précédée de toute une série d'opérations de traitement sur le signal de départ.
On peut encore ajouter que le schéma général d'une chaîne de télécommunications donné ne représente pas toutes les possibilités. Il présuppose que l'on crée, au profit des correspondants, une voie de communication, appelé circuit, mise à leur disposition exclusive pour la durée de la communication. Et même si l'exclusivité ne signifie pas que le canal de transmission ne puisse pas être partagé avec d'autres utilisateurs grâce à une opération de multiplexage, il n'empêche que le circuit est affecté à la communication pour toute sa durée. On ne retrouve pas toujours ce concept en transmission de données où certains protocoles prévoient l'envoi de paquets d'information, sans établissement préalable d'un circuit. C'est le cas notamment du protocole réseau utilisé pour l'Internet: le protocole IP.