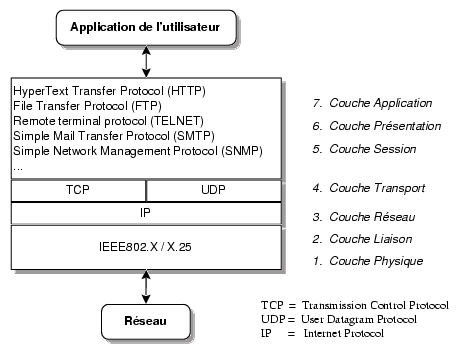
|
Devant le foisonnement de machines utilisant des protocoles de communication différents et incompatibles, la défense américaine a décidé de définir sa propre architecture. Cette architecture est à la base du réseau mondial Internet.
L'architecture Internet, qui se présente sous la forme d'une pile de protocoles, est basée sur le protocole IP (Internet Protocol) qui correspond au niveau 3 de l'architecture du modèle de référence OSI; quelques protocoles sont repris à la figure 3.5.
Le protocole IP a pour but de transporter les paquets, appelés datagrammes, d'une extrémité à l'autre du réseau. Les paquets sont indépendants les uns des autres et sont routés individuellement dans le réseau par chaque commutateur. La sécurisation apportée par ce protocole est très faible: pas de détection de paquets perdus ou de possibilité de reprise sur erreur. L'en-tête d'un paquet IP est illustré à la figure 3.6.
Le protocole TCP (Transport Control Protocol) regroupe les fonctionnalités de niveau 4 du modèle de référence. C'est un protocole assez complexe qui possède de nombreuses options permettant de résoudre tous les problèmes de perte de niveau inférieur. En particulier, les pertes pourront être récupérées par retransmission sur le flot d'octets. Le protocole TCP est en mode connecté, contrairement au deuxième protocole disponible dans cette architecture qui s'appelle UDP (User Datagram Protocol). Ce protocole se positionne aussi au niveau transport mais dans un mode sans connexion et avec pratiquement aucune fonctionnalité.
En guise d'illustration, la figure 3.7 analyse le contenu d'un paquet TCP/IP généré lors d'une connexion de transfert de fichiers par le protocole FTP (File Transfer Protocol).
Toute la puissance de l'architecture TCP/IP provient de la souplesse de mise en place au-dessus des réseaux existants. Par ailleurs, l'architecture inclut également, sans qu'elle ne soit définie, une interface d'accès au réseau. En effet, de nombreux sous-réseaux peuvent être pris en compte dans l'architecture TCP/IP, aussi bien de type réseaux locaux que réseaux longue distance. Cette généralité peut parfois être un défaut en ce sens que l'optimisation globale du réseau est effectuée par sous-réseau. En revanche, le coût de l'infrastructure est extrêmement bas. Le service rendu par ce réseau est du type ``best effort'', ce qui signifie que le réseau fait ce qu'il peut pour écouler le trafic.
Toute machine constituant un réseau de technologie Internet est identifiée par une adresse longue de 32 bits. Pour faciliter l'identification des adresses, on a défini un mécanisme permettant de nommer une machine, étant entendu que, puisque le protocole IP nécessite l'utilisation d'adresses IP, il doit être possible à tout moment de retrouver l'adresse correspondante. Le Domain Name System (DNS) est constitué d'une hiérarchie de serveurs capables de traduire un nom de domaine en une adresse Internet. Considérons par exemple, le serveur nommé www.yahoo.fr. Il lui correspond l'adresse IP suivante: 194.237.109.72. C'est précisément pour éviter que l'utilisateur ait à manipuler des adresses IP que le mécanisme de DNS a été mis en place.
La dénomination du DNS est basée sur les codes nationaux définis par l'ITU (.fr, .be, etc) gérés par des instances nationales et sur une série d'ajouts (.com, .edu, .org, etc). Pour toute destination exprimée sous la forme d'un nom de domaine, l'ordinateur émet d'abord une requête à un DNS, puis il utilise la véritable adresse IP pour contacter le correspondant. Pour éviter des appels répétés au DNS, l'ordinateur conserve en mémoire l'adresse IP des correspondants contactés précédemment.