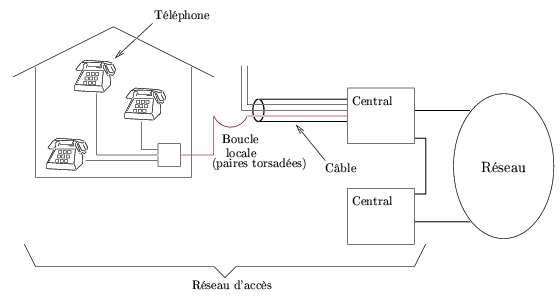
|
Le réseau téléphonique, aussi appelé Réseau Téléphonique Commuté (RTC) ou Public Switched Telephone Network (PSTN) a connu un développement extraordinaire à travers le monde. Du côté de l'abonné, le réseau se termine par une paire de fils de cuivre reliés à une centrale. Le téléphone qui s'y raccorde se charge de transformer le signal de parole en signal électrique. Le signal parvient ensuite à la centrale qui le dirige vers un autre abonné en passant éventuellement par d'autres centrales. Comme il a pour mission primaire de transporter des signaux vocaux, les caractéristiques du réseau téléphonique leur sont adaptées. Ainsi, la bande passante du signal transmis est limitée à l'intervalle 300 - 3400 [kHz] car l'énergie du signal de parole s'y trouve principalement. D'autre part, les délais de transmission sont très courts pour permettre un dialogue normal. Enfin, la transmission n'est jamais interrompue pendant la communication.
Le réseau téléphonique historique est constitué d'une série de paires de cuivre reliant chaque abonné au central. Notons qu'une paire est toujours dédiée à chaque utilisateur. La transmission s'effectue en général de manière analogique jusqu'au central téléphonique (cf. figure 3.21).
À l'entrée du central, le signal analogique est converti sous forme numérique et acheminé tel quel jusqu'au dernier central téléphonique. Le signal numérique est ensuite interpolé et transmis sur la paire de l'abonné destinataire. Ce schéma est illustré à la figure 3.22. Une représentation plus détaillée est fournie à la figure 3.23: on y voit les composants physiques.
Une seule paire de fils suffit théoriquement pour communiquer dans les deux directions. Il faut néanmoins mettre en place un mécanisme pour y parvenir. Dans le cas du téléphone analogique, on recourt à un transformateur hybride tel celui représenté à la figure 3.24. Ce transformateur effectue l'interfaçage entre un système à 2 fils et un système à 4 fils.
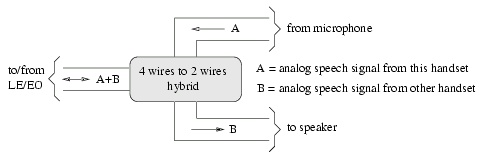
|
A chaque passage dans un central, le signal numérique est commuté, c'est-à-dire qu'il passe systématiquement d'une entrée spécifique à une sortie spécifique. La commutation est rapide car le chemin de passage est établi au début de l'appel, pour toute la durée de l'appel. On parle de circuit ou de mode connecté3.3. Le circuit est établi grâce à des protocoles de signalisation. Entre l'abonné et le central téléphonique, la signalisation s'effectue par l'envoi d'une combinaison de deux fréquences; ce mécanisme porte le nom de Dual Tone MultiFrequency, DTMF. Les fréquences associées aux touches du clavier sont représentées à la figure 3.25.
En ce qui concerne la bande passante, l'opérateur garantit la délivrance d'un canal transparent pour les fréquences comprises dans l'intervalle [300 Hz, 3400 Hz]; on parle de la bande vocale. C'est donc dans cette bande qu'a lieu le transfert du signal vocal ainsi que les informations numériques transmises au moyen d'un modem. Parmi les nombreuses normes de modems, citons la norme V90, qui permet la transmission de données pouvant atteindre 56 [kb/s], et la norme V92, qui ajoute une série de fonctions à la norme V90.
A priori, le réseau téléphonique n'est pas adéquat pour la transmission de signaux d'ordinateurs car ces signaux sont numériques à l'origine. Et pourquoi faudrait-il maintenir la connexion entre ordinateurs après qu'un message ait été envoyé? Le recours à des modems offre un première solution mais il y a mieux: le RNIS.
Le Réseau Numérique à Intégration de Services (RNIS), ou Integrated Services Digital Network (ISDN)en anglais, est l'équivalent numérique du réseau téléphonique analogique. Il utilise la même infrastructure physique mais tous les signaux véhiculés restent sous une forme numérique, ce qui le rend plus commode pour des applications non vocales. Il s'agit donc d'un prolongement de l'accès numérique jusqu'à l'abonné.
Le débit d'un canal RNIS est de 64 [kb/s]; il est assuré entre deux utilisateurs raccordés au RNIS. Le principe du RNIS n'est pas lié au type de câble employé et l'on pourrait très bien imaginer de faire du RNIS sur le câble coaxial des télédistributeurs.
Comme représenté à la figure 3.27, l'accès au RNIS se présente sous la forme d'un bus offrant plusieurs canaux en parallèle. Pour un accès de base, l'abonné dispose de 2 canaux à 64 [kb/s]. Ces canaux sont compatibles avec les canaux 64 [kb/s] utilisés entre centraux. Dès lors, il est tout à fait possible d'avoir une communication numérique à l'origine et une terminaison analogique.
L'usage d'une bande de fréquences limitée à la bande [300 Hz, 3400 Hz] n'a de sens que s'il s'agit d'établir une communication entre deux points distants. Bien entendu, rien n'interdit d'utiliser une bande plus large entre un abonné et le central téléphonique car le support est spécifique à un abonné. Le RNIS utilise cette astuce pour transmettre des signaux numériques dans une bande de fréquences, excédant la bande vocale, entre l'abonné et le central.
La transmission numérique à haut débit dans le réseau téléphonique par ADSL pousse le principe plus loin: la transmission de l'information numérique se fait hors bande vocale de manière à garantir la coexistence avec le signal vocal analogique usuel. Cette coexistence n'est effective que sur la paire dédiée car au franchissement du central téléphonique, les signaux sont séparés par filtrage et injectés dans des réseaux de transmission spécifiques. Cette séparation est illustrée à la figure 3.28.