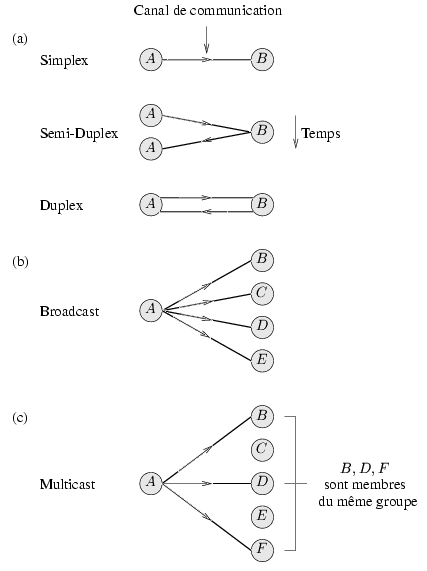
|
La télévision a démarré sous la forme d'un signal monochrome transmis par ondes radio. Ce signal occupe typiquement une bande passante de 5 à 8 [MHz]. Le mode de diffusion s'est ensuite diversifié puisque les télédistributeurs ont installé une structure câblée et on a vu apparaître des satellites de diffusion. La notion d'interactivité est absente de ce mode de diffusion.
Au début des années 1980, la télévision amorce un virage vers le numérique puisqu'on voit apparaître une première norme de compression vidéo -la norme H261- pour la vidéoconférence. Vient ensuite la norme MPEG-1 qui est destinée à permettre le stockage d'une séquence vidéo sur un CD-ROM avec une vitesse de transfert limitée à 1, 5 [Mb/s]. Les initiatives suivantes en termes de compression visent d'une part à offrir des qualité de télévision supérieures et à permettre le transfert d'images par des réseaux à faible capacité; elles conduiront aux normes MPEG-2 et MPEG-4 respectivement. Étant donné l'état de l'art actuel, on peut considérer aujourd'hui que la compression est un problème réglé.
Pour différencier les différentes offres de télévision interactive, nous proposons des critères appartenant aux deux familles suivantes:
Le premier critère de différenciation de service est la qualité du signal de télévision. Le tableau 3.6 reprend les ordres de grandeur typiques pour les débits des signaux numériques équivalents à des signaux analogiques.
|
D'une manière générale, les faibles débits sont alloués à des communications totalement bidirectionnelles et qui s'effectuent en temps réel.
Le second critère de différenciation de service est la nature de l'interactivité. L'interactivité peut être locale ou de réseau. L'interactivité locale est une interactivité qui reste proche de l'utilisateur. Lorsqu'il y a interactivité de réseau, un signal est renvoyé vers l'expéditeur par le réseau qui achemine le signal de télévision ou par un autre réseau servant de canal interactif. L'interactivité peut aussi s'obtenir en temps réel ou en temps différé. Par exemple, pour obtenir l'impression de temps réel lors d'une communication vocale, il faut impérativement que le délai n'excède pas 50 [ms].
La notion d'interactivité implique la présence d'un canal de retour. Les signaux d'interaction ne nécessitent pas de débits importants et le canal qui véhicule est généralement d'un très faible débit par rapport à celui qui transmet le signal de télévision numérique. Hormis le cas de la vidéotéléphonie, la télévision interactive est un service fondamentalement asymétrique.
Comme la voie descendante, c'est-à-dire celle qui va vers le spectateur, véhicule un haut débit, c'est principalement les réseaux à haut débit qui servent pour la télévision. La diffusion s'effectue classiquement par les réseaux de télédistribution, par satellite ou par ondes radio. La question de la transmission par Internet est plus délicate car les éléments du réseau Internet s'accommodent généralement mal des hauts débits, à fournir en temps réel. La transmission par ADSL est une solution possible, encore faut-il que la source soit située à proximité de l'abonné. Une alternative consiste à utiliser l'infrastructure de télédistribution pour intégrer signaux de télévision et transmission de données Internet; on parle de WebTV. Deux solutions technologiques sont possibles3.5: (1) les fenêtres de navigation sont affichées en sur-impression sur l'écran de télévision, (2) le signal de télévision est lui-même ``joué'' à l'intérieur d'une fenêtre de navigation (c'est un exemple de streaming video).
Enfin, concernant les modes de diffusion, on distingue:
Le dialogue client-serveur tel qu'on le retrouve dans la majorité des applications Internet (cf. figure 3.55) ne convient guère pour les transmissions en temps réel.
Soit à utiliser le protocole HTTP, toute information transmise générerait un accusé de réception. Ce surplus de trafic est indésirable d'autant plus que ce mode de fonctionnement amène des délais de transmission inacceptables.Le procédé utilisé pour la transmission de signaux interactifs en temps réel est celui de la figure 3.56. Une première liaison, plus ou moins fiable, gère la session et les conditions du transfert. Une seconde connexion fournit le flot de bits avec un délai aussi faible que possible. Un message perdu lors de la transmission de ce flot n'est jamais réémis.